Le petit village de Verrières, dans l’Orne, fut le berceau d’un épisode fulgurant de l’histoire agricole mondiale. C’est ici qu’a prospéré le cheval percheron. Histoire, grandeur et décadence d’une bête puissante à sang froid, convoitée jusqu’aux USA*.
L’église de Verrières garde la trace de cet étrange épisode. Ses vitraux neufs furent offerts par les familles Aveline, Chouanard et Boullay, à l’aube du XXe siècle quand elles étaient au sommet de leur puissance. Elles avaient fait fortune grâce à la création puis au commerce du cheval percheron. Tout comme la famille Fardouët qui, elle, reste absente du podium ecclésiastique. Par manque de foi plutôt que par manque de moyens.
Nombre d’auteurs affirment que le père fondateur de la race percheronne était un étalon nommé Jean Le Blanc, né en 1824, originaire de Gallipoli et descendant direct des pur sang arabes rapportés des croisades. Il s’agit certainement d’une légende comme tous les chevaux de trait s’en firent attribuer pour gagner leurs lettres de noblesse face au dédain que leur vouaient l’aristocratie et la haute bourgeoisie. La véritable naissance de la race percheronne a des origines moins romantiques : elle est l’œuvre d’une poignée de maquignons épaulés par des hommes d’affaires venus des États-Unis.
Il aura suffi de cent ans pour que la mythique race percheronne apparaisse, conquière tous les continents, révolutionne l'agriculture avant de retomber brutalement dans la marginalité. Aussi vite que les familles qui en étaient à l'origine.

Aux origines était le commerce
En effet, sous Napoléon III, l’agriculture commençait à se mécaniser. Faucheuse, trépigneuse, faneuse : les nouvelles machines exigeaient de plus en plus d’énergie pour être tirées. C’est pourquoi les grandes fermes céréalières de la Beauce fonctionnaient avec deux cheptels. D’un côté des bœufs, lents mais puissants, pour tirer les appareils les plus lourds, de l’autre des chevaux, plus faibles mais plus rapides, pour le transport des marchandises. Les éleveurs se mirent à rêver d’un animal idéal, combinant tous les avantages. Hélas, l’administration nationale des haras ne s’intéressait pas à la question agricole car sa mission était encore de préserver la remonte militaire. Les choses furent donc prises en main par le secteur privé.
Sous Napoléon III, l’agriculture commençait à se mécaniser. Les nouvelles machines exigeaient de plus en plus d'énergie pour être tirées.
En ce temps, les grands marchands de bestiaux s’organisaient sur un axe allant de Nogent-le-Rotrou vers Paris. Il n’avait pas échappé aux têtes pensantes de ce réseau que les chevaux du Perche, nourris à l’herbe riche d’un sol calcaire, développaient une ossature solide. On avait l’habitude d’y sélectionner les plus beaux spécimens, de les débourrer dans les fermes céréalières de la Beauce chez des dresseurs spécialisés, avant de les vendre ailleurs en France et dans le monde. Il n’en fallait pas plus pour attirer la curiosité d’un certain Mark W. Dunham, éleveur de l’autre côté de l’Atlantique, au fin fond de l’Illinois…
Le complot américain
Aux États-Unis, là aussi, on cherchait des chevaux mixtes, à la fois puissants et rapides, quand on avait seulement de fringants chevaux de cowboy du type Quarter horse. Mark Dunham était très en pointe sur son exploitation car un contrat lui permettait de tester, avant tout le monde, les nouvelles machines agricoles McCormick – il savait qu’un nouvel animal de trait serait bientôt nécessaire à toute ferme moderne. Il se mit en quête de la bête idéale et pensa la trouver dans les vallées du Perche. Suivi par d’autres businessmen ainsi que des techniciens comme James Harvey Sanders (qui avait déjà travaillé à l’élaboration de la race bovine Hereford), les américains vinrent appliquer les principes de l’amélioration génétique les plus en pointe et, dès les années 1870, établirent un livre généalogique de la race percheronne, en partenariat avec quelques commerçants locaux. L’anglais devint si courant dans les rues de Nogent-le-Rotrou qu’on la désignait comme une “banlieue de Chicago”.
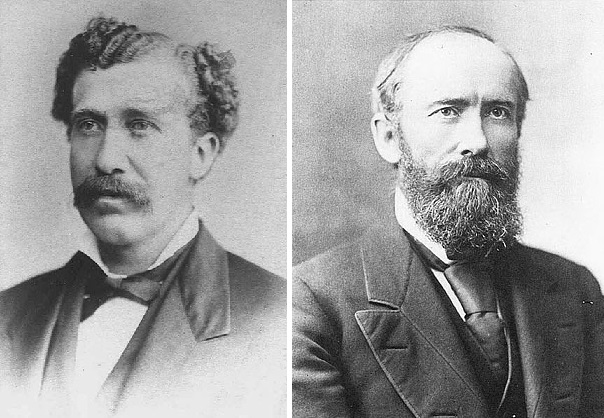
Le succès fut immédiat : le cheval percheron s’imposa comme étant le meilleur de tous les animaux de trait. Des éleveurs écossais tentèrent de l’égaler en développant le clydesdale. En Angleterre, ce fut le Shire. Les éleveurs du Nivernais proposèrent aussi leur alternative, semblable au percheron d’origine et dotée d’une superbe robe noire, mais ces éleveurs ne remportèrent jamais le marché car ils manquaient d’un vrai réseau de dresseurs, et leur race ne se défit jamais de son caractère rugueux. Il n’y eut guère que l’ardennais, venu de Belgique, pour tenir tête au percheron. Tranquille et très puissant, l’ardennais gagna rapidement le grand Est, de la Suède jusqu’à la Russie. Pour le ministère de l’agriculture belge, l’exportation des chevaux généra des fortunes équivalentes à celles du charbon sorti des mines.
La chute
Qui de l’ardennais ou du percheron devait gagner la bataille pour la suprématie mondiale ? C’est une autre guerre, entre les hommes cette-fois, qui devait en décider. Les combats de 1914 anéantirent physiquement tous les élevages du nord de l’Europe et le commerce de l’ardennais s’effondra quand, dans le même temps, les percherons se multipliaient tranquillement chez les fermiers américains et canadiens. Des dizaines de milliers traversèrent d’ailleurs l’océan pour servir de monture à l’armée française. Un recensement de 1930 dénombre 33 000 percherons inscrits aux États-Unis, contre seulement 8 800 ardennais, 1 500 shire et 1 400 clydesdale. Le plus emblématique des chevaux de traits avait survécu à la guerre, mais le progrès des machines, qui lui donnèrent naissance, allait finalement lui donner la mort.

Les tracteurs à moteurs existaient depuis 1900, mais les terrains accidentés des exploitations agricoles restaient difficilement praticables, et l’invention des tracteurs à chenilles ne s’avéra guère convaincante. C’est la révolution du pneu agricole, dans les années 1950, ainsi que la manne financière du plan Marshall qui permirent aux fermiers de passer au “tout pétrole”. C’est alors que toutes les races de trait périclitèrent dans le monde entier. Pour s’en débarrasser, on développa l’hippophagie, et la race percheronne perdit lentement ses caractéristiques pour devenir plus viandeuse et plus grasse. À force, sa chair elle-même passa de mode. Aujourd’hui, seuls quelques irréductibles étalonniers se battent pour redresser les effectifs en chute libre – on compte déjà 1 000 juments de moins que l’année dernière. Une demande subsiste pour les loisirs et les compétitions. À la marge, certains agriculteurs ressuscitent la tradition du cheval de trait, par plaisir ou par conviction écologique. Le percheron, donc, ne semble pas devoir disparaître. Sa gloire est bien passée, mais dans les mémoires, son mythe trotte encore.
__________
* Article réalisé avec l’aide aimable concours de Bertrand Langlois, chercheur retraité de l’INRA.











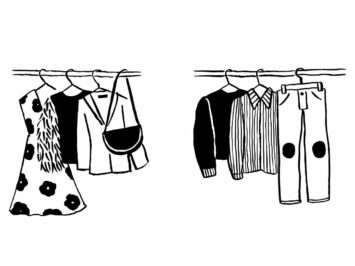

longue vie au cheval de trait
compagnon de misère de l’être humain qu’il soulage de l’effort et soutien moralement
par son courage, son endurance et sa présence apaisante
Article très intéressant, merci!
Dommage de ne pas avoir parlé du Brabançon (actuel Trait Belge). Si ma mémoire est bonne, il avait fait plus d’exportations dans le monde entier que l’Ardennais. (info à vérifier)