« La terre appartient à ceux qui la travaillent », scandaient les paysans qui suivaient Emiliano Zapata pendant la révolution mexicaine dans leur lutte contre les oligarchies foncières ; “terre et liberté” exigeaient les milices anarchistes espagnoles pendant la guerre civile, qui avaient compris qu’une société libre ne pouvait se construire que sur la base d’une répartition équitable des terres agricoles. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis que ces slogans ont cessé d’être chantés, mais pour les petits et moyens agriculteurs européens en 2025, ces principes restent tout à fait d’actualité.
Sur tout le continent, les terres rurales sont soumises à une pression sans précédent. L’expansion urbaine, la spéculation et la concentration menacent l’une de nos ressources les plus précieuses, la clé de notre indépendance alimentaire. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, rien qu’entre 2012 et 2018, l’Union européenne a perdu plus de 120 000 hectares de terres arables en raison de l’expansion urbaine. Dans le même temps, la concentration de la plupart des surfaces agricoles entre quelques mains rend difficile l’accès des jeunes au secteur : en 2020, 3,6 % des exploitations agricoles contrôlaient 52,5 % des terres arables, tandis que les deux tiers des exploitations comptait moins de 5 hectares. À cela s’ajoute l’intérêt croissant des grands fonds d’investissement pour l’acquisition de terres arables et leur mise en location dans le cadre de contrats à long terme, ce qui fait grimper la valeur des propriétés et exclut du secteur les projets disposant d’un faible capital de départ, tels que les jeunes ou les petits agriculteurs désireux de s’agrandir.
Le résultat de tous ces facteurs est clair : L’augmentation du coût de la terre conduit l’agriculture européenne vers son « ubérisation », vers une agriculture où les agriculteurs cessent d’être des propriétaires pour devenir des employés à temps partiel de quelques grandes entreprises, les seules à disposer d’un capital suffisant pour entrer sur le marché, et qui privilégient, avant tout, la maximisation du retour sur investissement. Un scénario aux antipodes de la tradition européenne des petites exploitations familiales, liées au territoire et aux produits locaux.
Dans ce contexte, des citoyens de différents coins du continent lancent des initiatives visant à protéger les terres agricoles de la spéculation et à garantir leur utilisation durable à long terme. Des projets qui, à travers différents modèles de gestion collective, tentent non seulement de préserver les territoires ruraux de l’urbanisation et de la spéculation, mais aussi de réimaginer la notion même de propriété des terres agricoles, en les considérant comme un bien commun qui devrait être géré pour le bénéfice de tous et non de quelques actionnaires.

Terre de Liens: Les pionniers français
L’organisation française Terre de Liens est peut-être l’exemple le plus paradigmatique de ce type d’initiative. Fondée en 2003, elle acquiert depuis lors des terres rurales pour les soustraire à la spéculation et les attribuer à de nouveaux agriculteurs.
Le cas typique est le suivant : Des porteurs de projet demandent à Terre de Liens de les aider à trouver des parcelles propices à leur installation, dans l’optique que l’association les acquière et les leur loue. Après avoir validé la solidité technique du projet, Terre de Liens initie une levée de fonds spécifique pour l’acquisition, et une fois devenu leur propriété, ils signent un bail rural environnemental qui permet au fermier d’utiliser la terre sans limite de temps à condition qu’il quitte la ferme lorsqu’il met fin à son activité agricole ou en cas de rupture des clauses du contrat.
Outre l’aide à la recherche de terres, Terre de Liens accompagne les débutants par des conseils méthodologiques et juridiques, les met en relation avec d’autres personnes dans la même situation, leur donne accès à des plateformes d’achat et de vente de terres, leur permet d’accéder aux administrations compétentes ou de tester leur activité dans des couveuses, parmi bien d’autres aspects. En résumé, Terre de Liens est une porte d’entrée vers l’agriculture pour tous ceux qui veulent s’y consacrer mais ne sont pas issus d’une famille d’agriculteurs, qui représentent aujourd’hui 60% des candidats, car ils n’ont pas le soutien d’un réseau familial ou de biens hérités.
Et cela aide non seulement ceux qui veulent commencer une carrière, mais aussi les agriculteurs sur le point de prendre leur retraite qui ne savent pas à qui confier la gestion de leur exploitation ou qui ne souhaitent pas transmettre leur savoir. Un cercle vertueux pour préserver la vocation agricole des terres et promouvoir des pratiques agricoles durables.
Tout cela est financé par deux entités : Une société d’investissement citoyen, la Foncière Terre de Liens, qui permet à chacun de devenir propriétaire solidaire en achetant des parts ; et une fondation, la Fondation Terre de Liens, qui peut recevoir des dons et des legs de terres, assurant ainsi leur préservation à perpétuité. Les résultats de cette formule sont éloquents : en plus de 20 ans d’existence, Terre de Liens a acquis, grâce au soutien de plus de 38 000 citoyens, plus de 300 fermes dans toute la France et a aidé à l’installation de plus de 700 agriculteurs sur 7 500 hectares réservés à jamais à l’agriculture biologique. Des chiffres et des faits qui prouvent concrètement qu’il est possible de créer un modèle économique viable qui met la terre au service du bien commun.

BioBoden: Le modèle coopératif allemand
La coopérative allemande BioBoden Genossenschaft a été fondée en 2015 en réponse à la concentration croissante des terres arables entre les mains d’investisseurs non agricoles. Son fonctionnement repose sur la participation citoyenne à travers l’achat de parts sociales de la coopérative, avec un investissement minimum de 1 000 euros ; BioBoden vise à ce que chaque membre soit symboliquement responsable d’au moins 2 000 m² de terres cultivées, chiffre résultant de la division des terres arables de la planète par la population mondiale. Les membres, comme il est d’usage dans le modèle coopératif, ont également une voix et un droit de vote dans les processus décisionnels internes de l’organisation.
Les fonds provenant de l’achat d’actions sont utilisés pour acquérir de vastes étendues de terres qui sont ensuite louées de manière permanente et à des prix abordables à des agriculteurs biologiques. BioBoden gère aussi directement certaines exploitations, dispose d’une fondation pour reprendre les terres des agriculteurs qui cherchent des successeurs responsables et aide les agriculteurs à commercialiser leurs produits.
BioBoden compte actuellement plus de 7 130 membres, avec le soutien desquels elle a obtenu 4 910 hectares de terres et s’est associée à 86 exploitations agricoles, ce qui prouve que la propriété collective des terres fonctionne également dans le cadre d’un modèle coopératif.

De Landgenoten : Crowdfunding pour les terres flamandes
De Landgenoten [Les Compatriotes] a vu le jour en 2014 en Belgique, dans la région des Flandres, en réponse à la pression croissante exercée sur les terres agricoles dans l’une des régions les plus densément peuplées d’Europe. L’organisation est une coopérative et une fondation qui achètent des terres agricoles avec l’argent des actionnaires et des donateurs, puis les louent à des agriculteurs biologiques par le biais de contrats à vie. Comme par le passé, elle donne également des conseils sur la manière de pratiquer une agriculture durable ou met en relation ceux qui quittent l’aventure avec d’autres qui souhaitent la poursuivre.
La participation minimale pour devenir membre de la coopérative est de 250 euros. Elle se distingue des participations demandées par des organisations similaires, car dans ce processus d’achat, les parts peuvent être directement attribuées à un projet spécifique, comme une forme de crowdfunding, permettant aux projets de suivre l’évolution de leur collecte de fonds. Un modèle original qui renforce la relation entre les membres et les agriculteurs.
Au cours de ses huit premières années d’activité, De Landgenoten a réussi à mobiliser plus de 1 600 membres de coopératives, a acquis 47 hectares de terre et a soutenu 14 projets agricoles. Des chiffres qui peuvent sembler modestes, mais qui doivent être replacés dans leur contexte, compte tenu du prix élevé des terres et de la rareté des terres arables disponibles dans la région flamande.

Red Terrae: Sauvetage des petites exploitations abandonnées en Espagne
En Espagne, Red Terrae a développé une approche différente (avec un rôle plus important pour les administrations locales) particulièrement adaptée au contexte espagnol, où l’abandon rural et le vieillissement de la paysannerie sont des problèmes urgents. Le réseau, né en 2012 à l’initiative de plusieurs municipalités engagées dans le développement rural et l’agroécologie, met en relation, grâce à son outil Banco de Tierras Agroecológicas (Banque de terres agroécologiques), les propriétaires de parcelles abandonnées et les agriculteurs à la recherche de terres à cultiver selon des méthodes agroécologiques. De leur côté, les mairies adhérentes au réseau jouent le rôle d’intermédiaire en garantissant des accords de transfert temporaire.
De cette manière, un triple avantage est obtenu : les propriétaires conservent l’usage de leurs terres et, en fonction de l’accord conclu, peuvent recevoir une petite compensation sous forme de produits ou de paiement ; les agriculteurs ont accès à des champs sans avoir à réaliser de gros investissements ; et les municipalités voient leurs zones rurales revitalisées par l’arrivée de nouveaux projets et de nouveaux habitants.
Actuellement, la banque de terres agroécologiques gère 250 hectares de terres abandonnées, bien qu’elle ait répertorié plus de 1 000 hectares susceptibles d’être utilisés dans le cadre de cette formule. Leur approche, adaptée à la réalité locale, montre que le remplacement des générations et les pratiques agroécologiques peuvent être encouragés sans investissement important, en tirant parti des ressources existantes et du potentiel de la collaboration entre les secteurs public et privé.
L’avenir de la terre en tant que bien commun
Bien que leurs approches varient en fonction du contexte national et local, tous ces projets révèlent qu’il existe des alternatives viables au modèle traditionnel de propriété des terres agricoles et que le processus actuel d’accumulation spéculative n’est pas inévitable. Et peut-être, plus important encore, ils montrent qu’il existe un groupe de citoyens engagés qui soutiennent l’agriculture durable et la vision de la terre comme un bien commun, et qui sont prêts à les soutenir à la fois économiquement et en y participant activement.
À ce stade, alors que certains de ces modèles ont plus de vingt ans d’existence, la question n’est plus de savoir s’ils sont viables, mais comment nous pouvons les développer pour atteindre un public plus large. Il est peut-être temps de reformuler la vieille aspiration zapatiste et de commencer à chanter « la terre appartient à ceux qui la protègent ». L’avenir de notre patrimoine agricole est littéralement entre les mains de chacun.
Auteur : Guillermo López Linares.










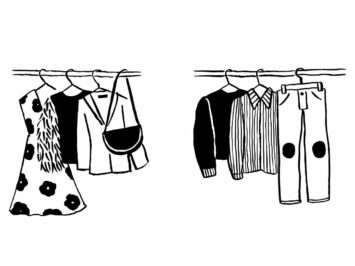

No Comments
Close