Une nouvelle feuille de route agricole pour l’Europe se profile à l’horizon, et le premier projet a déjà fait des vagues. Début juillet 2025, la Commission européenne a publié sa proposition initiale pour la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2028–2034. Cette proposition, qui prévoit des changements structurels majeurs et des réductions budgétaires importantes, a été largement rejetée par le secteur agricole. De nombreuses organisations d’agriculteurs appellent d’ailleurs à manifester à Bruxelles.
Mais que se joue-t-il vraiment ?
Dans cet article, nous décryptons les principaux changements proposés et analysons ce qu’ils pourraient signifier pour l’avenir de l’agriculture biologique et régénérative en Europe.
Est-ce sérieux ?
Ce qui a été présenté est une proposition initiale de la Commission européenne. Un long et complexe processus de négociation commence maintenant pour qu’elle devienne une loi, ce qui pourrait prendre un ou deux ans. Les trois institutions concernées (la Commission, le Conseil et le Parlement) devront négocier, et le résultat final est souvent très différent du premier brouillon.
C’est justement parce que ce n’est encore qu’un projet que le moment est crucial pour faire pression, tant au niveau national qu’européen. Rien n’est encore gravé dans le marbre pour 2028.

Le cœur du changement : un budget réduit et deux nouvelles zones de conflit
Pour comprendre cette proposition, il faut regarder trois changements interconnectés : un budget plus restreint, une nouvelle structure interne, et une nouvelle articulation avec d’autres fonds nationaux. Ensemble, ils créent deux nouveaux champs de bataille pour l’attribution des fonds.
1. Le point de départ : un plus petit gâteau
Le premier changement, le plus évident, est la réduction budgétaire. Le budget total de la PAC passerait de 387 milliards d’euros (pour la période actuelle) à 300 milliards pour 2028–2034. Corrigé de l’inflation, cela représente une baisse réelle de près de 30 %.
Ce n’est pas qu’une mesure d’économie : cela reflète un changement de priorité de l’UE vers des domaines comme la défense ou l’espace. En résumé : il y aura moins d’argent à répartir.
2. Premier champ de bataille : la guerre interne pour les financements
Deuxième grand changement : la suppression des “deux piliers” qui structuraient la PAC depuis des décennies.
- Le Pilier 1 finançait les paiements directs aux agriculteurs.
- Le Pilier 2 soutenait le développement rural, incluant les aides pour les mesures environnementales, l’agriculture biologique et les investissements pour la modernisation.
C’est par ce pilier que de nombreux agriculteurs engagés dans des pratiques régénératives pouvaient obtenir un financement.
La nouvelle proposition fusionne tout dans un seul fonds. Ce fonds agricole serait “protégé” (ring-fenced), ce qui signifie que les gouvernements nationaux ne pourraient pas utiliser cette enveloppe minimale pour d’autres politiques.
Mais cette protection crée une nouvelle compétition féroce à l’intérieur de cette enveloppe. Sans séparation entre les deux piliers, les mesures environnementales devront désormais se battre à armes égales contre le soutien au revenu de base.
Que signifie cette bataille interne pour la durabilité sur le terrain ?
C’est ici que les conséquences deviennent concrètes. La proposition marque un tournant dans la manière dont la durabilité est financée :
- Les conditions environnementales obligatoires pour tous (les fameuses BCAE – Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) disparaîtraient.
Ces règles minimales étaient nécessaires pour toucher les aides PAC : terres mises en jachère, rotations culturales, couvert végétal…
Chaque pays devra désormais définir ses propres “pratiques durables minimales”. - Les incitations volontaires pour les agriculteurs qui vont plus loin seront aussi à la discrétion des États membres.
Les éco-régimes (ou Eco-schemes) seraient intégrés au cadre existant des Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).
Historiquement, ces MAEC et éco-régimes finançaient des pratiques comme :
- le maintien de couverts végétaux,
- les bandes fleuries pour les pollinisateurs,
- l’élevage extensif,
- la conversion et le maintien en bio.
Avec la nouvelle structure, chaque gouvernement devra décider quelle part de son budget agricole protégé il consacre à ces mesures.
Cela pourrait être 30 %… ou seulement 5 %.
C’est là que réside le risque majeur : face à un budget global plus faible, un gouvernement pourrait décider de consacrer la quasi-totalité des fonds aux paiements de base, et laisser très peu de moyens pour accompagner la transition agroécologique.
3. Deuxième champ de bataille : la guerre externe pour les financements
Troisième changement : ce nouveau fonds agricole unique ne sera plus autonome. Il sera intégré à un “méga-fonds” national, aux côtés d’autres priorités comme les fonds de cohésion ou de développement régional.
La fameuse “protection” (ring-fence) ne garantit qu’un budget agricole minimum. Si le secteur veut plus de moyens pour des projets ambitieux (par exemple une transition bio à l’échelle nationale), il devra négocier chaque année face à d’autres ministères, et non plus au niveau de l’UE tous les 7 ans.
Chaque euro supplémentaire devra être arraché aux ministères de l’économie, de l’intérieur, de la santé… dans le même plan national.
Ce que cela signifie pour les agriculteurs : des risques et (quelques) opportunités

Cette nouvelle structure présente un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Avancées possibles :
- Plus de soutien aux jeunes agriculteurs : le quota minimum passe de 3 % à 6 % du budget, pour favoriser le renouvellement des générations.
- Paiements plus équitables (en théorie) : les mécanismes de plafonnement et de dégressivité seront renforcés, ce qui pourrait rediriger les aides vers les fermes familiales.
- Meilleure définition de “l’agriculteur actif” : pour mieux cibler les aides sur ceux qui travaillent effectivement la terre.
- Nouveau “service de remplacement” : pour faciliter les congés des agriculteurs.
Grands risques :
- La durabilité dépendra de la politique nationale : le budget pour le bio et le régénératif n’est plus garanti.
- Perte d’un cadre commun européen : chaque pays fixant ses propres règles, il y a un risque de “course au moins-disant environnemental”, au détriment des fermes exigeantes.
- Exclusion des retraités : à partir de 2032, les personnes touchant une pension ne pourront plus bénéficier des aides PAC — ce qui pourrait accélérer l’abandon des terres dans les zones rurales.
Conclusion : la politique nationale comptera plus que jamais
Le message de la Commission européenne est clair : plus de flexibilité, plus de pouvoir pour les États membres.
Mais pour les agriculteurs, cela signifie aussi que le soutien au bio et au régénératif dépendra fortement de la volonté politique de chaque pays.
À partir de 2028, il ne suffira plus de regarder vers Bruxelles. Il faudra agir au niveau national pour garantir un vrai soutien à l’agriculture durable.

Construire la résilience au-delà des subventions
Ce contexte d’incertitude politique met en lumière une vérité fondamentale : compter uniquement sur les aides publiques est une stratégie fragile.
L’engagement politique est crucial, mais la sécurité à long terme passe par la résilience des fermes elles-mêmes.
C’est là que le modèle de vente directe au consommateur devient un levier clé.
Pour les agriculteurs bio et régénératifs, créer un lien direct avec les consommateurs qui comprennent et valorisent leur travail offre une base économique plus stable.
Dans un monde où les politiques publiques peuvent changer à tout moment, le meilleur outil d’un agriculteur reste une ferme résiliente… et une relation directe avec ceux qui mangent ce qu’il cultive.










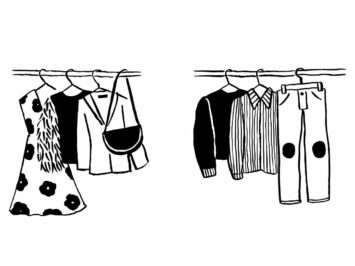

No Comments
Close