Alors qu’en 2020 la pandémie mondiale du Covid-19 conduit à la fermeture de multiples frontières, Jeanne Metayer démarre une nouvelle aventure agricole en tant que productrice. Sa ferme “Les 4 saisons de la Morinerie” se situe en zone urbaine, près de Tours, à la place d’un ancien lieu de promenade. En cultivant des produits biologiques qu’elle vend en circuits-courts uniquement, Jeanne y voit un moyen d’agir à sa propre échelle pour redonner du sens à ce que l’on a dans nos assiettes et relocaliser le système alimentaire, tout en préservant la biodiversité.
Une ferme qui agit à son échelle
Comptant plus de 75 variétés de fruits, légumes, et plantes aromatiques et médicinales différentes, “Les 4 saisons de la Morinerie” est une ferme de 3 hectares qui s’est spécialisée dans le maraîchage biologique intensif avec ses 5 employés.
C’est grâce à l’aide financière de la métropole de Tours et d’un grand nombre de bénévoles que le projet a aussi pu voir le jour. Selon Jeanne, la période Covid rythmée par les confinements et les couvre-feux a pu jouer en leur faveur. En effet, certains habitants ont repris conscience des avantages de manger local et ont aidé à monter les serres, les systèmes d’irrigation et à l’installation des cultures. Malheureusement, cette prise de conscience n’aura pas eu d’impact à long terme puisque dès le printemps 2021, les ventes de la ferme auprès des consommateurs se sont mises à chuter.

Pourtant, la productrice Jeanne Metayer croit fermement que la relocalisation du système alimentaire est essentielle et que nous avons tous un rôle à jouer. Si elle s’est reconvertie pour devenir néo paysanne, c’est avant tout pour être cohérente avec ses idéaux.
L’espoir d’un système alimentaire idéal à venir
D’un point de vue pragmatique, Jeanne nous décrit ainsi la situation actuelle des petits producteurs : “on vivote, on galère, on compte plutôt sur la mobilisation des gens mais on voit bien que cela ne suffit pas”. Elle fait ici référence à un manque d’aide de la part des régions et de l’État. Ce dernier a tendance à beaucoup aider les producteurs “plus conventionnels” sous prétexte qu’ils créent de l’emploi, au dépend des acteurs du changement comme Jeanne et son équipe. Il s’agit souvent de l’aide à l’hectare qui avantage les producteurs industriels, mais rarement de l’aide au temps de travail, au chiffre d’affaires, ou bien d’intérêt public en soutenant de manière significative les fermes biologiques.

Cependant, l’espoir fait vivre, et qui de mieux placé qu’une agricultrice dans une petite ferme biologique pour nous décrire son système alimentaire idéal ? Tout d’abord, il faudrait repenser notre imaginaire, en normalisant un système constitué seulement de fermes plus petites et plutôt collectives, qui feraient des ventes uniquement en circuits-courts. L’aspect collectif permettrait de diviser les astreintes et les risques, de permettre des décisions communes plus éclairées, et d’avoir un réseau fort et plus résilient en cas de crise.
Ces fermes seraient également pluri-activités et permettraient de nourrir la population française sans recourir à l’importation ou l’exportation, ce qui affaiblirait les agro-industries qui sont dévastatrices d’un point de vue environnemental, social et économique. Ces fermes se concentreraient également pour produire biologiquement. Enfin, il y aurait plus de femmes, notamment cheffes d’exploitation, ce qui n’est que rarement le cas aujourd’hui.
La sensibilisation : moyen de partage et de changement
Créer du lien est au cœur de cet idéal. Il ne s’agit pas seulement de produire et de se nourrir mieux, mais aussi de créer un réseau plus fort avec d’autres producteurs et avec les consommateurs qui sont acteurs du changement d’une autre manière : par leur soutien et leurs choix.
Une prise de conscience doit avoir lieu : consommer moins de produits exotiques et de produits transformés. Cela comprend de passer plus de temps en cuisine, qui ne doit pas être vu comme une corvée mais un moment de partage qui est bien plus gratifiant ; le goût est meilleur et l’on retrouve du sens à l’action de s’alimenter.
Pour le consommateur, accepter le circuit-court, c’est également renoncer à notre système de commercialisation actuel. Les mentalités peuvent changer. Il n’est pas nécessaire d’avoir de tout et tout le temps, mais nous pouvons apprendre à faire avec ce que l’on a et manger de saison. Loin d’être une limitation, cela laisserait de la place à plus de diversité dans nos assiettes.
“L’industrialisation de l’agriculture a poussé vers une restriction toujours plus forte des variétés, des formes, des goûts et des couleurs.”
En cultivant des variétés moins connues, on découvre de bonnes surprises, comme la chayotte ou la poire de terre, produits phares de la ferme. Il faut admettre que des produits comme la patate douce sont longtemps restés dans l’ombre, alors qu’elle est désormais extrêmement populaire.

Pour aller plus loin et partager sa vision, Jeanne essaye de sensibiliser le plus de monde possible.
“Le partage fait partie du métier, c’est quelque chose qu’on aime et qui nous anime, ce n’est pas seulement le travail au champs.”
Les idées ne lui manquent pas, et chaque été a lieu dans la ferme un festival, représentatif de son amour pour la création de lien. C’est l’occasion de souder l’équipe et de fédérer petits et grands avec 3 concerts et un spectacle, ou encore de faire des visites guidées et de se ravitailler avec de bons produits. “C’est une façon de faire vivre le lieu différemment”, nous explique la productrice.
Dans ce cadre, la ferme organise des visites pour les écoles pouvant durer la journée entière, où les enfants ont l’opportunité de mettre les mains dans la terre et voir les insectes durant des ateliers. Des prestations pour des entreprises sont en outre commandées, afin de permettre aux employés de se reconnecter avec leur alimentation. Enfin, “Les 4 saisons de la Morinerie” accueille chaque année des stagiaires, car il n’y a que très peu de diplômes pour se lancer dans le maraîchage biologique, et le principal du métier s’apprend sur le terrain.

Toujours dans cette optique de créer du lien, les producteurs de la ferme ont décidé ensemble de refuser une subvention pour un épandeur à compost, pour donner place à un chantier participatif. Tous les printemps, avec l’aide d’une quinzaine de bénévoles, un après-midi est consacré à l’épandage de compost de fumier. En automne, un autre chantier participatif met cette fois la récolte à l’honneur pendant une semaine. Tout le monde met la main à la pâte, et les carottes, betteraves, et bien d’autres légumes défilent à la chaîne.
S’engager pour la biodiversité
Pour protéger la biodiversité, Jeanne et les autres producteurs pratiquent la technique de l’occultation, qui consiste à broyer les restes de la culture après récolte pour ensuite recouvrir d’une bâche opaque. Cette technique est courante pour le maraîchage biologique intensif, et l’objectif est de permettre au sol de se réchauffer sans laisser passer de lumière, afin que les mauvaises herbes germent puis meurent puisque la photosynthèse est impossible. Durant ce temps, insectes et vers de terre s’activent et laissent le moment venu un terre plus fertile, meuble et facile à travailler. “Les 4 saisons de la Morinerie” laisse une fois dans l’année chaque zone en occultation pour environ 4 mois. De plus, il existe une rotation spatiale des cultures, comprenant un jardin qui reste en engrais vert toute l’année, et qui n’est donc pas exploité.

“On a pensé notre système de culture avec la biodiversité fonctionnelle”, nous explique la productrice. Ce type de biodiversité vise à soutenir les producteurs en favorisant les espèces utiles à leurs cultures, et en essayant de contrôler les espèces nuisibles grâce à leurs prédateurs. Les solutions sont diverses et s’installent un peu partout dans le paysage de la ferme. Des arbustes près des cultures servent à abriter des oiseaux qui mangent les chenilles, un tas de pierre attend tranquillement l’arrivée d’un serpent qui luttera contre la pression des rongeurs, des ronces cachent le terrier d’un renard, et l’on aperçoit parfois une chouette ou un couple de faucon sur un perchoir. La biodiversité est aussi végétale, puisqu’aucun arbre planté pour les oiseaux n’est de la même espèce.

Jeanne explique qu’il faut continuellement essayer de se former, pour voir ce qu’il est possible d’améliorer. Son engagement pour la biodiversité demande aussi de s’informer et d’agir de manière proactive. Par exemple, lorsqu’il y a trop de pucerons, elle achète des larves de chrysopes. De même pour des bourdons qui sont achetés chaque printemps pour polliniser les premières tomates. La ferme plante des fleurs pour que les insectes puissent y résider en permanence, et effectue des fauches tardives afin qu’il y ait toujours une bande enherbé.
“Notre but, c’est d’avoir un sol vivant.”
Pour cela, Jeanne met aussi du foin dans les cultures, pour aider des champignons à se développer. En parallèle, le terre bénéficie d’un engrais vert grâce à des cultures qui ne sont pas récoltées et qui vont se décomposer, pour créer de la biomasse au sol.

Ce système alimentaire idéal que Jeanne nous a décrit avec passion, une fois aidé par l’État et les politiques publiques locales, pourrait enfin donner envie aux jeunes générations de s’installer, et ne pas user les producteurs qui ont eu le courage de mettre leur travail au service de leurs idéaux.
Autrice : Violette Cadrieu










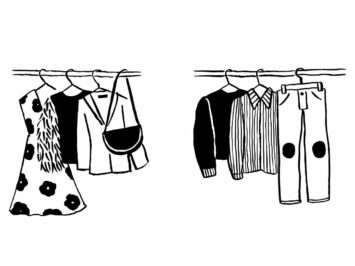

No Comments
Close