Aujourd’hui, les étiquettes « durables », « écologiques », « responsables » foisonnent sur les rayons. Pour le consommateur, c’est souvent une promesse: mieux pour l’environnement, moins d’impact, transparence. Mais comment démêler le vrai du greenwashing? Et quel rôle jouent les labels dans le système alimentaire européen actuel?
Les éco-labels sont nés de la nécessité de donner au consommateur un repère face à une offre croissante de discours marketing « verts ». Selon la FAO, un éco-label est un sceau de qualité environnementale appliqué à des produits qui ont un impact moindre sur l’environnement que leurs équivalents concurrents.
Ils reposent sur la théorie de l’« information asymétrique »: le producteur connaît les pratiques réelles, mais l’acheteur non: le label sert à réduire ce déséquilibre. Dans l’idéal, le label crédible est indépendant, rigoureux, audité et transparent. L’idée est séduisante: orienter les achats vers des produits à moindre impact, encourager des pratiques vertueuses, et inciter les entreprises à rendre leurs chaînes plus durables.
En parallèle, l’OCDE rappelle que pour que ces labels soient utiles, ils doivent inspirer confiance: critères clairs, audits indépendants, et pouvoir sanctionner les abus. (Enabling Trust in Food Labels, 2025)
Quand le label influence aussi le goût
Avez-vous déjà eu l’impression qu’un produit « éthique », « local » ou « à faible empreinte carbone » avait meilleur goût ? Des recherches récentes montrent que manger un aliment qui correspond à ses valeurs peut réellement influencer la perception du goût et, dans une certaine mesure, le plaisir ressenti.
Une étude menée en 2013 par l’Université de Gävle, en Suède, illustre ce phénomène. Des étudiants ont goûté deux cafés prétendument différents: l’un « éco-responsable », l’autre non. La majorité a déclaré préférer le goût du café « durable », alors que les deux tasses étaient identiques. Fait encore plus frappant: lorsque certains participants ont appris qu’ils avaient préféré le café non durable, ceux qui accordaient une grande importance à l’écologie ont tout de même affirmé qu’ils seraient prêts à payer plus cher pour la version « verte ».
Ce que les chercheurs ont appelé « l’effet halo vert » montre à quel point les labels peuvent influencer nos choix et nos perceptions, parfois plus que la réalité du produit. Les marques le savent, et certaines en jouent habilement. Le marché du « green » est lucratif: selon McKinsey et Nielsen IQ, les produits mettant en avant des engagements environnementaux ou sociaux représentent déjà plus de 56% de la croissance des ventes dans l’alimentation aux États-Unis. Les produits cumulant plusieurs allégations, par exemple « bio » et « équitable », progressent même deux fois plus vite que ceux n’en affichant qu’une.
Mais derrière cette tendance positive, une question persiste : ces promesses sont-elles toujours fondées? En l’absence de règles strictes et de contrôles rigoureux, les frontières entre communication engagée et greenwashing deviennent floues.
Des labels trop nombreux, trop disparates

Dans l’Union européenne, il existe plus de 200 labels liés à la durabilité dans le secteur alimentaire, chacun avec ses critères, ses méthodes, et parfois ses contradictions. La Commission européenne travaille actuellement à harmoniser ce système d’étiquetage, notamment via la révision du règlement Green Claims et les propositions du « Food Information to Consumers ». Le Parlement européen suit lui aussi ces évolutions pour encadrer les allégations environnementales.
Selon les études de l’INRAE, l’un des défis majeurs consiste à rendre lisibles les labels pour le consommateur: quelle différence entre « durable », « bas carbone » ou « biodiverse »? Les essais consommateurs montrent que la simplification aide à la compréhension, mais risque de masquer des nuances importantes (INRAE, Harmonising environmental labelling in Europe).
C’est dans ce contexte qu’émerge Planet-Score par exemple, une proposition française soutenue par plusieurs acteurs de la recherche et de l’agriculture durable. Construit à partir de la base de données publique Agribalyse, il évalue les produits alimentaires selon trois grands critères: le climat, la biodiversité et les pesticides. Contrairement à d’autres systèmes d’éco-notation qui se limitent à l’empreinte carbone, Planet-Score prend en compte des indicateurs souvent négligés: impact sur les pollinisateurs, pollution des sols, et mode de production.
Son ambition est double: offrir une lecture plus complète de l’impact environnemental d’un aliment et encourager des transitions concrètes vers des pratiques agricoles plus saines. Ce modèle a le mérite d’introduire une logique de transparence et de progrès plutôt qu’une simple comparaison punitive entre produits.
Et maintenant, quelle suite pour les éco-labels?

Pour que les éco-labels contribuent réellement à transformer le système alimentaire, plusieurs évolutions sont nécessaires. L’enjeu majeur reste l’harmonisation européenne: établir des critères partagés, exigeants et vérifiables, capables de garantir la fiabilité des allégations tout en évitant la prolifération de labels concurrents. Cette cohérence devra s’accompagner d’un renforcement du contrôle et de sanctions dissuasives en cas de dérive.
Parallèlement, des outils comme le Planet-Score montrent qu’il est possible de proposer une notation agrégée, lisible et fondée sur des données transparentes. Ces systèmes, s’ils restent rigoureux, pourraient offrir aux citoyens un repère clair pour orienter leurs choix sans sacrifier la complexité des enjeux environnementaux.
Enfin, il faudra renforcer l’éducation du consommateur car comprendre ce que signifient réellement ces logos, c’est aussi reprendre du pouvoir sur son assiette.










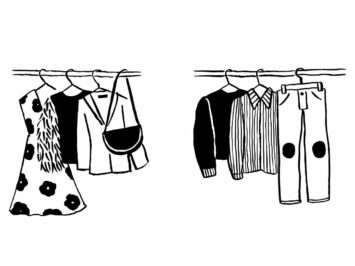

No Comments
Close