Depuis des décennies, l’agriculture intensive s’est imposée comme modèle dominant, avec pour objectif principal d’augmenter les rendements. Efficaces sur le court terme, ces pratiques compromettent la résilience et la durabilité des systèmes agricoles face aux aléas climatiques et aux maladies avec des conséquences néfastes sur la biodiversité. Pourtant, sans vie dans les champs, aucune culture ne peut prospérer durablement. Nourrir l’humanité ne devrait pas affamer le vivant. Et si nous changions de cap ?
Pourquoi certaines pratiques menacent-elles la biodiversité ?
Vider les champs de vie en tuant les sols

Longtemps considéré comme une bonne pratique agricole, le labour profond bouleverse l’équilibre naturel des sols. En remuant profondément les strates du sol, les micro-organismes qui vivent normalement dans l’obscurité se retrouvent à l’air libre et meurent. Cette hécatombe va venir enrichir le sol la première année, mais en réalité, le sol est déjà mort. L’autre conséquence néfaste d’un labour si profond est la libération du carbone stocké dans le sol accentuant le réchauffement climatique.
À cela s’ajoutent les passages répétés des machines lourdes, qui tassent les sols et écrasent les galeries d’insectes. Résultat : une terre asphyxiée, incapable d’absorber l’eau correctement, où les plantes poussent mal.
Un désert vert : la monoculture

Visualisez ces champs de maïs à perte de vue, ce blé sur des hectares sans haies ni bosquets. Ce n’est pas un cauchemar, c’est notre réalité actuelle qui a préféré privilégier la monoculture industrielle pour avoir une rentabilité immédiate. Cette disparition de la diversité des espèces de plantes cultivées n’est pas sans conséquences sur les insectes, les oiseaux et bien sûr le sol. Pourquoi ? Parce qu’un sol qui voit passer toujours les mêmes racines s’épuise. Il perd ses nutriments, sa vie et surtout sa capacité à se régénérer naturellement grâce à une diversité d’espèces qui pourraient lui apporter beaucoup.
Le résultat ? Les agriculteurs compensent la pauvreté accrue de leur sol par toujours plus d’engrais chimiques. Un cercle vicieux s’installe : les ravageurs et maladies se propagent à très grande vitesse puisque leurs prédateurs ne sont pas là et que les cultures affaiblies sont faciles à trouver. Une occasion de plus d’utiliser massivement des pesticides et des fongicides qui fatiguent la terre et rendent les plantes encore plus vulnérables.
Pesticides et herbicides : l’hécatombe silencieuse
Les herbicides, utilisés pour faire place nette autour des cultures tuent tout sur leur passage. Le glyphosate et ses cousins sont là pour éliminer toutes les plantes considérées comme indésirables : pissenlit, trèfle, ortie… Sauf que ces plantes sont essentielles pour nourrir nos pollinisateurs. Nos champs sont rapidement entourés d’un désert végétal et animal.
Comme si cela n’était pas suffisant, l’utilisation massive de pesticides aggrave la situation en entraînant la mort de nombreux pollinisateurs. C’est le cas des néonicotinoïdes qui sont d’une redoutable efficacité. Utilisés en enrobage de semences (surtout pour le maïs, la betterave ou le colza) ces produits imprègnent toute la plante tant et si bien qu’il n’est plus besoin de retraiter pendant toute la durée de vie de la plante. C’est pratique non ? Oui, mais non. Ces produits contaminent l’ensemble de la plante jusqu’au pollen et au nectar. Résultat : les abeilles s’empoisonnent à petites doses, perdent leur orientation, deviennent stériles ou ne retrouvent plus leur ruche et finissent par mourir. Une catastrophe invisible mais bien réelle, qui menace directement notre capacité à produire fruits et légumes.

Une autre agriculture est possible (et elle existe déjà)
Face à ce cercle vicieux dans lequel s’est lancée l’agriculture d’aujourd’hui, des milliers d’agriculteurs et d’agricultrices inventent d’autres voies plus respectueuses du vivant et économiquement viables.
Le Bec Hellouin : la ferme modèle de la permaculture
Nichée dans l’Eure, la ferme du Bec Hellouin est emblématique car elle associe agroécologie, permaculture et sobriété énergétique. Depuis 2003, elle produit des légumes toute l’année sur de petites surfaces, en s’appuyant sur les services rendus par la nature (paillage, culture en lasagnes, associations végétales…). En 2011, une étude de l’INRA a même montré que cette ferme était plus rentable à l’hectare que bien des exploitations conventionnelles. À partir de 2015, ils ont synthétisé l’ensemble de leurs recherches en matière de maraîchage biologique et créé le concept de microferme permaculturelle qui connaît un fort essor en Europe et dans divers pays.

En Espagne : l’essor de l’agriculture régénérative, la Junquera
Située dans la région de Murcie, au sud de l’Espagne, la ferme La Junquera est un exemple inspirant de transition vers l’agriculture régénérative. Confrontée à des sols dégradés et à des conditions climatiques arides, cette exploitation a adopté des pratiques visant à restaurer la santé des sols et à améliorer la résilience face au changement climatique depuis 2015. L’utilisation de variétés anciennes de céréales (plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes) ainsi que l’amélioration de la santé des sols (compostage, paillage, rotation des cultures) a permis à la ferme de stabiliser ses récoltes et de réduire l’érosion du sol.
En Autriche : la biodiversité au cœur de l’exploitation, Grand Farm
Dirigée par Alfred Grand, cette ferme de 90 hectares associe l’agroforesterie, le maraîchage et sur la santé des sols bien sûr (production de vermicompost). Elle sert aussi de centre de recherche, collaborant avec des universités pour inventer l’agriculture de demain. En 2024, elle a reçu la certification “Regenerative Organic Certified”, une première en Europe.
Et maintenant ?
Changer de modèle agricole est urgent. Non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi pour garantir une alimentation durable, des sols vivants, et des campagnes résilientes face au changement climatique. Les solutions existent. Elles sont souvent locales, parfois expérimentales, mais elles partagent un même socle : remettre le vivant au cœur des pratiques agricoles.










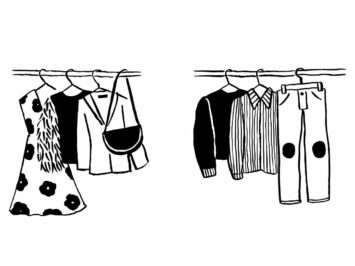

No Comments
Close