Alors que l’accord Mercosur ouvre le marché européen à des importations agricoles sud-américaines, le débat dépasse la seule question commerciale. C’est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu : l’Europe doit choisir entre un système mondialisé aux normes disparates et l’essor d’autres modèles, comme celui des circuits courts, porteurs d’une alimentation plus saine, transparente et durable.
Le retour du Mercosur dans les débats européens soulève une question fondamentale : quel modèle agricole et alimentaire voulons-nous pour l’Europe ? Cet accord commercial implique l’ouverture du marché européen à des produits agricoles sud-américains issus d’une agriculture intensive, souvent industrialisée, principalement au Brésil, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.
Ces produits, bien qu’encadrés par des quotas, sont surtout destinés à être intégrés dans des denrées transformées – viandes hachées, charcuteries, plats préparés et conserves – largement présentes dans les grandes et moyennes surfaces. Cette réalité fait craindre aux producteurs européens une concurrence accrue, d’autant que les normes sociales, sanitaires et environnementales en vigueur dans les pays du Mercosur sont souvent moins exigeantes que celles de l’Union européenne.
Cette ouverture ne se traduira pas nécessairement par une inondation immédiate des rayons européens. Plusieurs enseignes de grande distribution ont d’ores et déjà affirmé leur volonté de limiter la présence de ces importations, consciente de la nécessité de protéger l’agriculture locale et de préserver la confiance des consommateurs.

Le dilemme n’est donc pas tant une opposition frontale entre agriculture locale et modèle industriel, mais plutôt un défi d’équilibre. Quel poids voulons-nous allouer à un système agroalimentaire globalisé, basé sur des volumes massifs et des normes hétérogènes, face à une demande croissante pour une alimentation transparente, respectueuse de la santé et de l’environnement ?
La crise de confiance autour de l’alimentation est palpable. Scandales sanitaires à répétition, opacité des circuits industriels, méfiance envers les processus mondialisés : autant de facteurs qui renforcent le besoin d’un lien direct avec ceux qui produisent notre nourriture.
Dans ce contexte, les circuits courts apparaissent comme une véritable alternative. Ils garantissent traçabilité et fraîcheur, réduisent le gaspillage alimentaire et valorisent les terroirs européens. En renouant directement avec les producteurs, les consommateurs retrouvent une confiance souvent perdue dans leur alimentation. Les producteurs, de leur côté, trouvent du sens dans la relation directe et peuvent mieux valoriser leurs pratiques.

En réduisant les marges superflues et le temps écoulé entre récolte et consommation, ces circuits rendent possible une alimentation plus fraîche, plus nutritive et à un prix juste pour le consommateur. Dans le même temps, ils assurent aux producteurs des revenus suffisants pour investir dans des modes de production plus vertueux, comme l’agriculture biologique ou régénérative, respectueuses du climat, des sols et des humains. Loin d’être un luxe élitiste, cette voie alternative démontre qu’il est possible de concilier accessibilité, qualité et durabilité.
La souveraineté alimentaire de l’Europe dépendra grandement de sa capacité à protéger ses producteurs, à assurer la qualité sanitaire de ses aliments et à proposer des alternatives crédibles aux consommateurs. Ces derniers, à travers leurs choix quotidiens, jouent un rôle clé dans la construction de ce futur alimentaire.
La véritable décision ne se joue pas uniquement à Bruxelles ou Brasilia, mais chaque jour dans nos assiettes, à travers la valorisation d’une agriculture qui respecte la planète et les humains, qui protège le tissu rural, et qui consacre un nouveau sens à l’acte de se nourrir.
Il est temps de dépasser les faux débats pour engager une transition écologique ambitieuse, sociale et juste, fondée sur la restauration des sols, la biodiversité, et la résilience des territoires. Car c’est seulement ainsi que l’Europe pourra préserver son agriculture, garantir sa sécurité alimentaire, et répondre aux attentes légitimes de ses citoyens.
Le Mercosur nous tend un miroir. Voulons-nous un système alimentaire globalisé, opaque et mondialisé, ou voulons-nous une agriculture locale, transparente et équitable ? L’avenir de notre souveraineté alimentaire ne se joue pas demain, il se joue ici et maintenant. Il se construit dans chaque acte, dans chaque geste, dans chaque alliance entre producteurs et consommateurs. Il se construit par la prise de conscience et la mobilisation collective.
Juliette Simonin – Co-fondatrice de CrowdFarming
Philippe Crozet – CEO de la Ruche qui dit Oui!










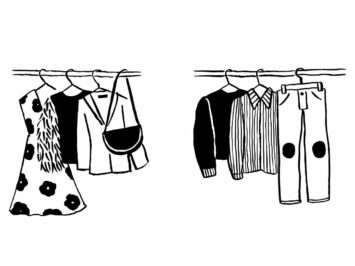

No Comments
Close