Depuis quelques jours, l’hexane est au cœur d’une polémique en France.
À l’origine: la publication par Greenpeace France le 22 septembre avec les résultats d’une enquête sur l’hexane, un solvant massivement utilisé dans la production d’huiles végétales et l’alimentation animale.
Considéré comme un « auxiliaire technologique », la loi n’impose pas de l’indiquer sur l’étiquette. Résultat: des traces d’hexane peuvent se retrouver dans les produits finis — en particulier les produits transformés — sans que les consommateurs en soient informés. Les tests réalisés par Greenpeace révèlent que des résidus de ce composé chimique sont présents dans de nombreux aliments du quotidien comme les huiles alimentaires, le lait (y compris infantile), le beurre et la volaille.
En raison des dangers que l’hexane représente pour la santé publique, Greenpeace exige l’interdiction de son utilisation dans la production alimentaire. L’enjeu dépasse l’actualité: il met en cause les règles qui encadrent la production alimentaire en Europe — et la transparence envers les consommateurs.
L’hexane, c’est quoi ?
L’hexane est un mélange d’hydrocarbures volatils (principalement n-hexane) très efficace pour dissoudre les lipides. Dans l’industrie agroalimentaire, il sert d’« agent d’extraction »: on trempe des graines oléagineuses (colza, tournesol, soja, etc.) dans le solvant pour en extraire un maximum d’huile, puis on évapore/ « désolvante » et on raffine. Ce procédé permet d’extraire jusqu’à 97% de l’huile, pour des rendements très élevés et des coûts ajustés.

Pourquoi le débat maintenant ? Une évaluation qui date des années 1990
Dans l’UE, l’hexane est autorisé comme solvant d’extraction par la directive 2009/32/CE, avec des limites maximales de résidus (LMR):
- 1 mg/kg dans les huiles et beurre de cacao
- 10 mg/kg dans les produits protéiques dégraissés et farines dégraissées (30 mg/kg pour certains produits de soja vendus au consommateur)
- 5 mg/kg pour les germes de céréales dégraissés.
En septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) publie un rapport technique concluant qu’une réévaluation complète est nécessaire, car le dernier avis qui a conduit à autoriser l’hexane en alimentation remonte au Comité scientifique de l’alimentation (SCF) de 1996 et présente des angles morts (par exemple, il ne prend pas en compte l’exposition chronique).
En mai 2025, la Commission mandate formellement l’EFSA; l’Autorité a donc lancé un appel à données et vise à partager un avis dans les prochaines années.
La filière, elle, répond qu’elle respecte la réglementation et rappelle l’importance du solvant pour garantir volumes et prix.
Pour les huiles végétales, l’UE fixe des LMR chiffrées et les échantillons analysés s’y conforment. En revanche, pour les produits d’origine animale et l’alimentation animale, il n’existe pas de limites spécifiques pour l’hexane: on peut donc y détecter des traces sans que cela constitue une infraction — souvent par “transfert” depuis les tourteaux utilisés en élevage. Ce vide réglementaire tient à un cadre ancien, fondé surtout sur des données d’inhalation et ne couvrant pas bien l’exposition chronique par ingestion, d’où la remise en question actuelle.
“La réglementation européenne actuelle encadre de manière très insuffisante la présence des résidus d’hexane dans les produits de grande consommation. Elle indique une limite maximale de résidus (LMR) pour certains produits (dont les huiles), qui repose sur des données toxicologiques obsolètes, fournies par l’industrie elle-même, datant de 1996.” – Dossier de Presse de Greenpeace
Avril, pivot de filière, tient le frein
Selon le dossier de Greenpeace, Avril (5ᵉ groupe agroalimentaire français, propriétaire notamment de Lesieur et de Sanders) occupe une position pivot de la trituration en France: il transformerait plus de la moitié des graines, dont 93% dans des usines recourant à l’hexane, ce qui en ferait le premier utilisateur agro-industriel de ce solvant.
Le paradoxe : les alternatives mécaniques existent et 2/3 des usines françaises fonctionnent sans hexane, mais près de 90% des graines continuent d’être transformées dans des sites qui y recourent, notamment chez Saipol, Cargill et Bunge. Avril possède aussi des capacités 100% mécaniques, même si minoritaires.
Quelles alternatives à l’hexane ?
Parallèlement, des alternatives existent déjà, avec des compromis différents en termes de rendement, de coût et de qualité:

- Procédés mécaniques (pressage/centrifugation à froid) : c’est la référence pour les huiles vierges (ex. olive), obtenues sans solvants et sous conditions n’altérant pas l’huile ; elles préservent les composés d’intérêt, mais donnent en général des rendements plus bas que l’extraction au solvant. Par définition juridique et interprofessionnelle, les huiles d’olive vierges (dont la vierge extra) sont obtenues uniquement par des moyens mécaniques ou physiques, sans solvants, sous des conditions n’altérant pas l’huile (lavage, décantation, centrifugation, filtration). L’usage de solvants comme l’hexane y est interdit.
- CO₂ supercritique (SFE-CO₂) : solvant « propre » réutilisable, facile à éliminer (pas de résidu organique), déjà courant dans l’agro (café, houblon) et appliqué aux huiles ; il demande un investissement et une énergie plus élevés, mais permet des huiles de haute qualité et des coproduits dégraissés sans raffinage.
- 2-méthyloxolane (méthyloxolane, 2-MO) : solvant biosourcé évalué par l’EFSA, qui ne soulève pas de préoccupation de sécurité aux MRL proposées pour remplacer l’hexane dans l’extraction d’huiles et de protéines végétales ; il est déjà pris en compte par le cadre européen sur les solvants d’extraction. Avantage : rendements proches de l’hexane et compatibilité avec des lignes existantes.
- Extraction aqueuse enzymatique (AEE) : utilise eau + enzymes pour libérer l’huile et, potentiellement, co-valoriser protéines et fibres. C’est une piste prometteuse et « verte », encore moins mature industriellement (choix des enzymes, temps de procédé, coûts).
En résumé: il existe des alternatives techniquement crédibles — du 100% mécanique aux solvants biosourcés et au CO₂ supercritique — mais leur déploiement à grande échelle dépendra des incitations réglementaires, des coûts et d’un pilotage filière pour accompagner la transition.
Si l’hexane persiste, c’est aussi parce que le lobbying verrouille le changement. Les grands acteurs de la trituration ont tout intérêt à prolonger la vie d’usines calibrées pour le solvant, repousser toute révision des seuils et gagner du temps sur les investissements de substitution. Résultat: statu quo réglementaire depuis près de 30 ans, alternatives sous-dimensionnées, et un cadre qui protège surtout l’existant. Dit autrement, un verrouillage par influence qui fait passer l’optimisation industrielle avant la santé publique et la transparence.
Et en « biologique » ?
Le cahier des charges bio européen encadre les procédés; les solvants chimiques ne font pas partie des procédés autorisés pour l’extraction des huiles alimentaires: on exige des méthodes mécaniques/physiques. Les listes d’auxiliaires autorisés (règlement (UE) 2021/1165) n’incluent pas l’hexane.
Concrètement, que peut faire le consommateur ?
- Chercher les mentions: « vierge », « vierge extra », « première pression à froid » (pour les huiles concernées), et/ou le label bio. Ces indications renvoient à des procédés mécaniques.
- Savoir décrypter: « huile de tournesol/colza » sans autre précision veut souvent dire raffinée (donc probablement issue d’extraction au solvant avant raffinage).
- Suivre l’actualité réglementaire: l’EFSA réévalue le dossier, et la Commission pourrait mettre à jour le cadre si de nouvelles données le justifient.
- Pétition Greenpeace France pour l’interdiction de l’hexane en alimentation: à signer si vous souhaitez soutenir une révision réglementaire rapide et la substitution par des procédés/solvants plus sûrs.










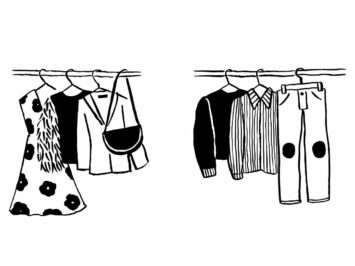

No Comments
Close